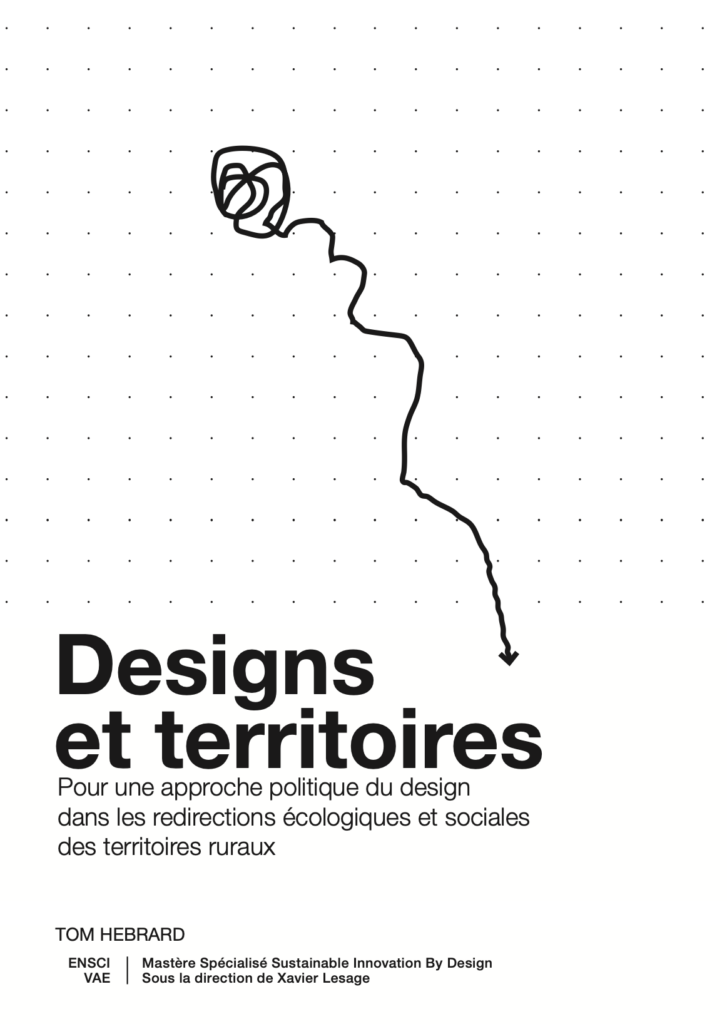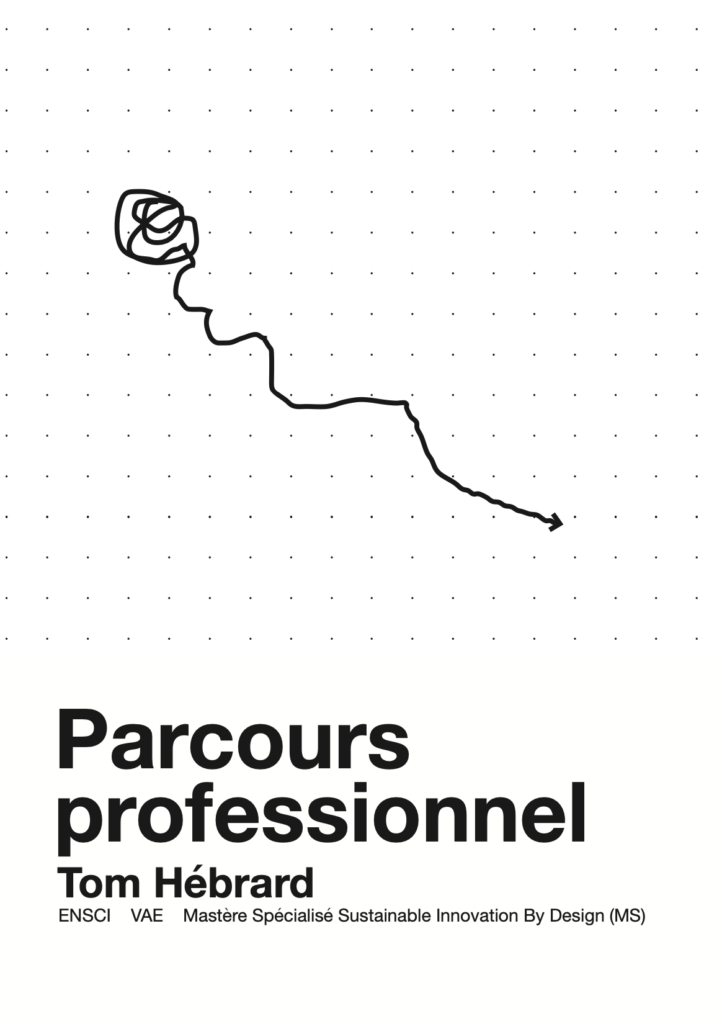Pour une approche politique du design dans les redirections écologiques et sociales des territoires ruraux
En 2024, après 3 ans d’activités au tiers-lieu paysan de la Martinière, je m’engage dans l’écriture d’un mémoire pour prendre du recul sur les implications de ce travail de terrain sur le monde du design, et sur les défis à relever pour la discipline.
Dans le secteur, il n’aura échappé à personne que l’implication des designers dans le développement territorial était une tendance. Pourtant il y a de quoi s’interroger quand on voit par exemple que le design est mobilisé pour optimiser les pertes de service public ou encore pour produire des dispositifs de concertation citoyenne qui éloignent les habitant.e.s des enjeux politiques de fond.
Le memoire qui s’intitule « Pour une approche politique du design dans les redirections écologiques et sociales des territoires ruraux » interroge la culture et l’éducation politique en design.
A travers les cas spécifiques qui sont étudiés dans le document, quels déplacements de pratique s’opèrent en s’impliquant dans une ferme paysanne ? Comment, en se rattachant à des horizons de société différents de ceux qui dominent dans la discipline (globalement solutionnistes, technologiques et capitalistes), les designers peuvent contribuer ou pas à l’évolution de nos modes de vie ? Quels engagements politiques prendre et comment organiser son activité et plus généralement le secteur du design en conséquence ?
Ça n’est qu’une ébauche de réflexions dont pas mal de fils sont à approfondir. Au plaisir d’en discuter.
Résumé
Le design est fortement mobilisé depuis 10 ans auprès d’acteurs des politiques publiques à destination des territoires, notamment ruraux, par des collectifs pluridisciplinaires alliant design, sciences
humaines et sciences politiques. A l’heure où cette démarche est devenue aussi importante que les disciplines historiques liées aux spécialités industrielles, il convient de s’interroger sur ce que peut le
design et comment certaines méthodologies et pratiques semblent efficaces ou non pour participer à des mutations écologiques et sociales sur les territoires, que ce soit dans les manières de produire
ou de s’organiser collectivement.
Mobilisé très largement par entreprises et pouvoir publics, le design semble peu impliqué dans une réflexion sur ce à quoi il participe à une échelle plus large. Il convient de revenir sur la nécessité de
l’élaboration d’une pensée et d’une éducation politique des acteurs du design et d’une éducation au design de celles et ceux qui le mobilisent qui participent à l’évolution de modes de vie et, in fine,
de choix de société.
En ce sens, le compagnonnage historique du design avec l’industrie, les modèles capitalistes et les politiques néo-libérales sont interrogés à la lumière de nouveaux professionnels du design qui
portent une charge critique, participent à l’élaboration de projets politiques par le biais de leurs pratiques.
Ces approches témoignent d’une vision de société qui prend comme horizon de référence des modes de vie différents, inspirés par exemple des pensées éco féministes de la subsistance, de pensée post-urbaine, biorégionaliste ou encore d’une économie des communs et de l’entraide. Ces approches riches et complexes rouvrent les possibles. Leur analyse offre des pistes pour le repositionnement de la discipline, son enseignement et son implication dans les territoires.
Lien vers le mémoire théorique :
Lien vers le mémoire professionnel :